Chêne pubescent
Quercus pubescens

Cuillère en bois de Chêne pubescent
Voilà des semaines, si ce n’est des mois, que je reporte la sculpture de cette cuillère en bois de Chêne pubescent. La réputation du chêne l’a précédée… et cette branche a fait honneur à sa réputation. Plus le couteau s’approche du cœur du bois, moins il y pénètre. Il faut avancer un petit copeau à la fois. C’est un long travail d’approche qui laisse du temps pour affiner son projet de sculpture. Mais quel plaisir ! Ce bois là est d’une autre trempe, il ne joue pas dans la même cour… son toucher, son veinage, sa couleur, sa solidité, quelle noblesse !
Dans la famille Fagaceae, je demande...
Cette cuillère en bois de Chêne pubescent est la 38e sculptée pour mon défi consistant à tailler autant de cuillères différentes qu’il y a d’essences d’arbres répertoriées dans la flore forestière française.
Le Chêne pubescent appartient à la famille des Fagacées qui comprend environ 900 espèces réparties en 7 à 9 genres, les plus connus étant : Castanea (châtaignier) ; Fagus (hêtre) ; Quercus (chêne). Au sein du genre Quercus se comptent encore 200 à 600 espèces (chiffre variable selon les auteurs, vu le nombre important d’hybrides)… ce qui semble logique puisque son aire de répartition s’étend des froides latitudes aux zones tropicales de l’Asie et des Amériques. Pour ma part, j’ai intégré à la liste du défi 9 espèces courantes en France :
- Chêne sessile (Q. petraea) ;
- Chêne pédonculé (Q. robur) ;
- Chêne chevelu (Q. cerris) ;
- Chêne écarlate (Q. coccinea) ;
- Chêne vert (Q. ilex) ;
- Chêne des marais (Q. palustris) ;
- Chêne tauzin (Q. pyrenaica) ;
- Chêne liège (Q. suber) ;
- et bien sûr le Chêne pubescent ici présent (Q. pubescens).
Mangeons des glands !
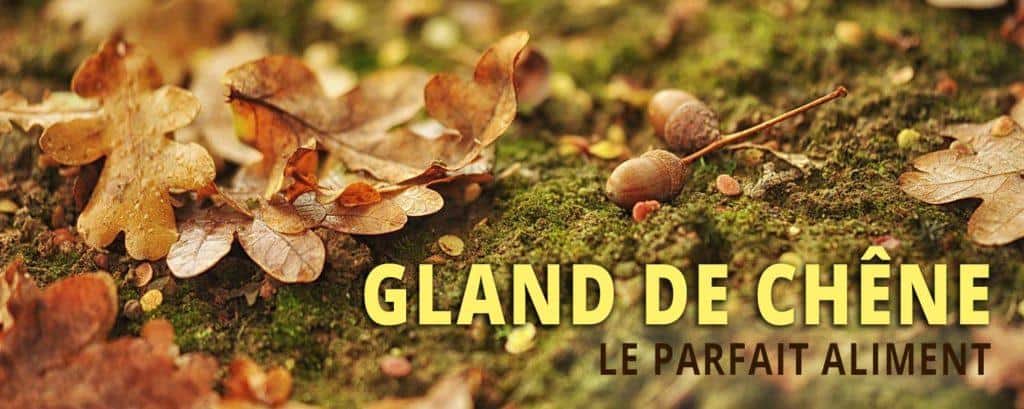
Qu’est-ce qu’un gland (sur le plan botanique) ?
Sur le plan botanique, le gland est un akène, c’est-à-dire un fruit sec indéhiscent (qui ne s’ouvre pas) et ne contenant qu’une seule graine. Le gland est enveloppé partiellement à sa base par une cupule (cavité en forme de petite coupe).
Le gland est riche en amidon (un glucide complexe, à hauteur de 30-35%), il contient également des protéines (4%), des lipides (4%) et des sucres (10%). Cette riche composition en fait un fruit très nutritif pour l’homme comme pour les animaux. Les glands fournissent environ 400 calories pour 100 grammes. Ils sont riches en acides gras polyinsaturés, vitamines C et B6, magnésium, calcium, cuivre, manganèse et potassium.
Les glands se cueillent à l’automne. Lorsqu’ils sont arrivés à maturité, ils tombent au sol. Laissez ceux qui sont encore attachés dans l’arbre, ils ne sont pas encore mûrs. La période de récolte se situe au mois d’octobre, parfois dès fin septembre, jusqu’à la Toussaint et courant novembre. Précautions : jetez ceux qui laissent apparaître des trous d’insectes, et ceux qui flottent quand vous les couvrez d’eau.
Le gland est la nourriture habituelle des sangliers, ours, chevreuils, écureuils, mulots, campagnols, pics, sittelles, pigeons ramiers, geais des chênes…
Mais le gland contient également des tanins (7 à 10%), substance amère et astringente qui, si elle est ingérée en grande quantité, provoque chez l’homme des troubles digestifs et des maux de tête. Wikipedia indique : pour peu qu’on arrive à les consommer crus, les glands ont des effets rapidement toxiques (constipation, lésions rénales, troubles neurologiques).
Les glands qu’on dit « doux »
Les glands de certaines espèces de chênes ont une teneur en tanins plus faible, ce qui leur donne une saveur plus douce et les rend donc consommables. Ils sont alors appelés « glands doux ». Parmi les espèces de chênes à glands doux en Europe, citons une variété de Chêne vert (Quercus ilex ballotta) et certaines variétés de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Chêne liège (Quercus suber) et Chêne pubescent (Quercus pubescens).
Les méthodes pour retirer le tanin des glands amers
La lixiviation à chaud
Il est possible d’éliminer le tanin des glands car celui-ci est soluble dans l’eau : il faut pour cela procéder à une lixiviation (extraction d’un produit soluble par un solvant, en particulier l’eau). La méthode la plus connue consiste à hacher finement ou à écraser le gland débarrassé de sa peau, coque et cupule, puis à le faire bouillir dans plusieurs eaux. Au début, l’eau se teinte, de chocolat léger à rose. Quand la couleur ne change plus, il faut alors jeter l’eau et recommencer. Généralement, au bout de trois ébullitions, l’eau reste claire et l’amertume a disparu avec les tanins.
Le blog du parti préhistorique partage son expérience pour facilité l’écorçage des glands : Fendre les glands et les griller légèrement dans une poêle couverte afin de pouvoir ensuite les écorcer. Attention, sous la coque solide, il y a une peau, sur l’amande, à retirer également ! Autre technique pour faciliter l’écorçage : entailler l’enveloppe extérieure des glands et faire cuire dans l’eau durant 15 minutes.
Deux astuces permettent d’accélérer le processus d’extraction des tanins. Les amérindiens ajoutaient à l’eau une grosse poignée de cendres de feu de bois, car la potasse contenue dans la cendre capte les tanins. Les Corses, quant à eux, utilisaient une poignée d’argile, qui capte également les tanins.
La purée obtenue peut être consommée salée ou sucrée, ou séchée sur une clayette et pulvérisée pour être mélangée à de la farine dans la confection de pains ou de gâteaux très nutritifs. François Couplan [ livre Le régal végétal ] indique que cette farine peut se conserver plusieurs mois et que, si une moisissure se développait sur une farine de glands humide, celle-ci avait des propriétés antibiotiques.
La lixiviation à froid
La méthode de lixiviation à froid consiste à faire tremper les glands sans peau dans de l’eau plusieurs jours en changeant l’eau chaque jour jusqu’à suppression de l’amertume. Cette technique, selon Couplan, était utilisée par les indiens : ils laissaient tremper les glands écrasés (enfermés dans un sac de toile) plusieurs jours dans l’eau d’une rivière.
Une autre méthode citée par Wikipedia consiste à étendre un linge (par exemple un drap) sur du sable puis à disposer la farine en une mince couche sur le linge. De l’eau est ensuite versée sur la farine jusqu’à ce que l’amertume de la farine ait disparu. L’eau et les tanins s’écoulent à travers le linge.
Enfin, une troisième méthode évoquée par Couplan consistait à enterrer les glands entiers dans un sol humide et à les y laisser de plusieurs mois à une année : il étaient alors devenus noirs et doux.
Vous trouverez sur cette page en anglais du site paleotechnics plusieurs vidéos illustrant la préparation de la purée de glands.
Le maltage
Michel Brunner [ livre Arbres géants de Suisse ] évoque une autre processus de désamérisation des glands : le maltage. Ce principe consiste à faire germer les fruits avant le traitement pour entre autres atténuer les substances amères.
Préparer du pain à la farine de glands
Les glands sont consommés par l’homme depuis très longtemps, les plus anciennes traces remontent à 15000 ans. On sait qu’au Néolithique (-9000 à -3300 ans avant J.-C.) ils étaient consommés régulièrement. Les espèces européennes, aux glands plus ou moins amers, ont toutes été consommées par l’homme. Elles ont notamment servi, lors des mauvaises récoltes, à compléter la farine pour accroitre le volume panifiable. Concernant plus précisément les glands du Chêne pubescent, ils ont longtemps été utilisés en Italie et en Provence, réduits en farine avec des figues sèches, pour faire une sorte de pain.
Le site www.natures-paul-keirn.com partage cette méthode pour faire du pain à partir de la purée de glands obtenue par lixiviation : il faut piler avec de l’eau pour former une pâte, style pâte à pain. A cet instant, soit on soulève la pâte à la main une centaine de fois pour y incorporer des bulles d’air ; soit on utilise la levure du boulanger pour que ces bactéries fabriquent des bulles de gaz carbonique au sein du pain. Creuser une petite fosse (20 cm x 50cm x 25xm de profondeur), la remplir de braise sur 10 cm, puis de cinq à dix centimètres de gravier ; placer le pain à cuire, recouvrir à nouveau de cinq centimètres de gravier. A même la braise, la croûte serait noire, brûlée, et l’intérieur cru ! La chaleur doit être intense (comme dans un four de boulanger) mais bien répartie sur la masse du pain. Quand il est possible d’y enfoncer la lame d’un couteau et la remonter sans qu’elle adhère, le pain est cuit.
Le racahout
Le racahout (mot venant de l’arabe racaou) est une fécule alimentaire employée au Moyen-Orient et dans les pays arabes, notamment pour donner de l’embonpoint aux femmes… En France, au début du XXe siècle, cette préparation (poudre grisâtre) était commercialisée en pharmacie sous l’intitulé commercial de Racahout des Arabes. Connu pour ses qualités reconstituantes, elle était proposée comme aliment fortifiant pour les enfants.
La farine de gland est l’ingrédient de base du racahout. Il était composé également de farine de riz, de fécule de pomme de terre, de cacao, de salep de Perse (poudre de tubercules de diverses espèces d’orchidées), de sucre, de vanille… On la diluait dans de l’eau et du lait pour en faire une bouillie ou du potage.
Vous trouverez une recette de chocolat chaud onctueux, à l’ancienne, façon racahout, sur cette page du site cuisine-maison-comme-autrefois.
Le café, un autre usage alimentaire du gland
François Couplan [ livre Le régal végétal ] indique que : torréfiés, les glands ont été utilisés comme succédané de café, et leur décoction est astringente et stomachique. Cette pratique a notamment permis, durant la première guerre mondiale, d’augmenter le volume du café alors devenu rare et hors de prix. L’auteur, dans Le petit Larousse des plantes qui guérissent précise que ce café de substitution est excellent pour l’estomac et qu’il n’excite pas.
Pour réaliser son café de gland, il suffit de torréfier (à la poêle ou au four) des glands doux préalablement réduits en morceaux, ou de torréfier la farine séchée et réduite en poudre issue d’une purée de glands amers (dont on a dissous les tanins).
Une autre recette, présentée sur le site mr-plantes.com conseille de mélanger les glands à des pois chiches : Dans une grande poêle chaude, faites torréfier des glands de chêne et des pois chiches (proportion de 2 pour 1), en les remuant en permanence (5 à 10 minutes, ne pas trop les torréfier). Broyer le mélange afin d’obtenir une poudre brune : le café de glands. Mélangez une demi-tasse d’eau (150 ml) et 1 à 3 cuillères à café de poudre, puis laissez bouillir pendant 2-3 minutes. Filtrer ou laisser se déposer le café de glands de chêne au fond de la tasse, et buvez chaud.
Sur le site lebonheurestdanslanature, la blogueuse Elodie, apprentie naturopathe écolo, donne son avis sur ce succédané de café (sans les pois chiches) : Difficile de remplacer le café et pour être honnête, je n’ai pas adoré cette boisson. Si vous êtes curieux, je vous conseille de tester tout de même, ce n’est pas mauvais non plus (chacun ses goûts 😉 ). En tout cas c’est original, avec un arrière goût de noisette.
Chênes pubescents : les arbres remarquables
Chênes remarquables en Europe
Le site Monumentaltress référencie près de 400 chênes pubescents parmi lesquels figurent :
- le plus large, en Italie, en face de Pratolino à Vaglia (municipalité de Firenze), avec une circonférence de 7,32 mètres (en 2000) et un âge d’environ 420 ans ;
- le plus haut vit également en Italie, le long de la via Fabio Severo à Trieste, avec une hauteur de 28 mètres ;
- le plus âgé est possiblement aussi italien : le Quercia di Donato, le long de la Via dei Cappuccini à Scurcola Marsicana, dans les Abruzzes : il aurait 768 ans, avec une marge d’erreur de 50 ans. Son concurrent est Tchèque et a exactement 818 ans (photo ci-contre). Il est situé dans le Gelände des Schlossparkes à Lechovice (district de Znojmo).
Chênes remarquables en France
Le Chêne pubescent est un « petit chêne » : il ne mesure qu’entre 10 et 25 mètres de haut avec un tronc souvent court et tortueux (plus long et droit lorsqu’il vit en forêt). On se rend compte que ce n’est pas le plus majestueux des chênes français à la lecture du livre Arbres d’exception, les 500 plus beaux arbres de France de Georges Feterman : si l’auteur recense plus d’une centaine de chênes remarquables en France (la plupart de l’espèce Chêne pédonculé), seules cinq références de chênes pubescents sont citées par l’auteur :
- l’étonnant chêne dans les rochers (4,20 mètres de circonférence, env. 150 ans) à Quenza en Corse du Sud (photo ci-contre à droite) ;
- le gros chêne de Saint-André (5,10 mètres de circonférence, env. 350 ans), dans le Gers ;
- le chêne blanc des Huguets (5 mètres de circonférence, env. 400 ans) à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne ;
- le chêne Merlin (5 mètres de circonférence, env. 400 ans) à Plan d’Aups-Sainte-Baume dans le Var ;
- les deux chênes (6,80 mètres de circonférence, env. 400 ans) à Murs dans le Vaucluse.
Chênes remarquables en Bourgogne
Alain Desbrosses présente un seul Chêne pubescent remarquable dans le premier tome des Les arbres remarquables de Bourgogne. Le Chêne pubescent de Rully (Saône-et-Loire) : un chêne de taille modeste, haut de 12 mètres pour une circonférence de 2,50 mètres, situé dans une station « méridionale » du département, sur un coteau ensoleillé.
Chêne pubescent : connaissance et reconnaissance
Étymologie du chêne
Le chêne a une étymologie complexe qui puise ses racines dans plusieurs couches linguistiques. Comme l’indique wikipedia : le nom de chêne renvoie ainsi à quatre étymons différents : l’indo-européen *dreu-, *perkʷus et heyǵ-, et le gaulois *cassanos.
- Les étymons indo-européens *dreu-, *deru-, *doru– évoquent la solidité, la force, la dureté. Ils sont soit à l’origine de termes reliés aux arbres : dendrochronologie, dryades, druide, etc., soit à l’origine de termes pour désigner directement les arbres (comme le mot anglais tree, arbre). Les grecs nommaient les chênes drus, ce qui signifie tout simplement l’arbre, car ils considéraient le chêne comme l’archétype de tous les arbres. Le breton derv, le gallois derw, le gaélique dair, le tchèque dub, le polonais dąb, etc. signifient tous chêne, l’arbre par excellence.
- L’étymon *perkʷus est à l’origine du mot attribué au genre scientifique, le latin quercus.
- L’étymon heyǵ- est notamment à l’origine des termes allemand Eiche et anglais oak qui désignent le chêne.
- Le gaulois *cassanos est à l’origine du bas latin cassinus et de latin médiéval casnus (IXe siècle), qui a donné l’ancien français chasne (XIIe siècle), chesne (XVIIIe siècle), et aujourd’hui chêne.
Le Chêne pubescent est nommé Chêne blanc en Provence, blacho en provençal. Cette dénomination sert soit à distinguer le Chêne pubescent du Chêne vert, l’autre chêne méridional, soit par évocation du duvet grisâtre qui recouvre généralement la face inférieure de ses feuilles. Ainsi, en Périgord, le Chêne pubescent est dénommé Chêne noir pour souligner son écorce sombre.
Enfin, un lieu planté de chênes est une chênaie.
Distribution
En Europe, le chêne avait presque complètement disparu du fait des glaciations de l’ère quaternaire.
L’impact des glaciations sur la flore européenne
J’ouvre une parenthèse à ce propos car il est souvent question dans les articles de ce site de l’impact des glaciations sur la flore européenne. Les glaciations quaternaires sont la succession d’au moins 17 périodes glaciaires (de 50 à 100 000 ans chacune) survenant régulièrement depuis 2,58 millions d’années. Chacune de ces périodes se caractérise par un refroidissement plus ou moins important du climat européen, et notamment le développement d’inlandsis sur le continent. Un inlandsis, ou calotte polaire, est un glacier de très grande étendue qui recouvre la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d’épaisseur. Il en existe encore deux aujourd’hui sur Terre : l’inlandsis de l’Antarctique et l’inlandsis du Groenland. Entre chaque période glaciaire, c’est l’éclaircie : des périodes interglaciaires, plus chaudes, qui durent chacune entre 10 et 20 000 ans. Ces variations climatiques de grande ampleur ont contraint d’innombrables espèces végétales et animales à abandonner leur territoire ou à s’éteindre. Elles ont eu d’avantages d’impacts en Afrique et en Europe, où la Méditerranée et les barrières montagneuses orientées Est-Ouest ont gêné la migration des espèces, qu’en Amérique du Nord et en Extrême-Orient, où aucune barrière n’a freiné la fuite et la reconquête du vivant.
Le chêne, passager semi-clandestin de l’homme préhistorique
Le chêne n’aurait jamais dû reconquérir ses territoires perdus : du fait du poids des fruits / graines qui tombent au pied, juste sous les branches (comme pour le Châtaignier et le Marronnier d’inde), un chêne ne progresse naturellement que de 100 mètres par siècle… soit quelques kilomètres seulement depuis la dernière glaciation. Comment alors le Chêne a t-il pu reconquérir toute l’Europe en seulement 10000 ans ? Pour Andrée Corvol [ livre Éloge des arbres ], qui soulève cette anomalie bio-géographique, c’est l’homme préhistorique – qu’il renomme pour l’occasion chêneur-cueilleur – qui a permis cette véloce expansion. Car le chêne était un arbre capital pour nos ancêtres : ils s’y abritaient grâce à ses branches solides et accessibles, mangeaient ses glands, tannaient les peaux des bêtes féroces avec son écorce, brûlaient son bois pour se chauffer et cuire leurs aliments… Ils l’ont donc, volontairement ou pas, emporté avec eux lors de leurs migrations. Wikipedia confirme cette expansion rapide : Confinés dans trois zones refuges (péninsule ibérique, le sud de l’Italie et les Balkans) au cours de la dernière période glaciaire, les chênes européens ont très rapidement, en moins de 8 000 ans, colonisé le nord de l’Europe (…) ils atteignent ainsi, 6000 av. J.-C., les limites nord de leur aire actuelle (le sud de la Scandinavie), ce qui correspond à une progression de 380 mètres par an.
Le Chêne pubescent, espèce sub-méditerranéenne typique
Le Chêne pubescent ceinture parfaitement l’ère du Chêne vert, essence méditerranéenne. C’est donc un sub-méditerranéen typique, héliophile et thermophile mais supportant le froid. Au sud de son ère, mélangé au Chêne vert, le Chêne pubescent colonise les lieux frais, les versants nord, il monte en altitude jusqu’à 1500 mètres ; au nord de son ère, il se mélange aux autres chênes mais colonise les pentes ensoleillées et abritées, sur sol calcaire, de l’étage collinéen. Il apprécie les steppes forestières où il pousse aux côtés de l’Alisier blanc, du torminal, de l’Érable champêtre, des cornouillers mâle et sanguin, du nerprun. Dans les régions agricoles, comme en Bourgogne, les chênaies pubescentes naturelles ont disparu, elles ont été transformées la plupart en vignobles et en vergers. Il est commun dans toute la moitié sud de la France, abondant dans le midi et en Corse. Il est absente en Bretagne et dans les Landes. Au-delà de nos frontières, il est présent dans tout le sud et le centre de l’Europe, de l’Est de l’Espagne à la Crimée et l’extrême ouest du Caucase.
Identification
Le Chêne pubescent a un houppier ample et clair. Son tronc est souvent court et de forme tourmentée. Son écorce noirâtre s’épaissit avec le temps et se fissure assez rapidement. Ses rameaux de l’année sont pubescents et grisâtres. Ses bourgeons sont bruns, ovoïdes et pointus. Ses feuilles caduques sont alternes, glabres dessus et pubescentes en dessous, dotées d’un limbe de 6 à 8 centimètres à lobes triangulaires et oblongs. Il s’agit d’une espèce monoïque, produisant des chatons mâles et jaunâtres qui pendent, en avril, à la base des jeunes rameaux, ses fleurs femelles, aux stigmates rouge vif se trouvant à leur extrémité. Ses glands sessiles sont groupés (Source : Futura-sciences).
Pierre Lieutaghi dans Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux, précise que le Chêne pubescent est une essence très variable, tant par la taille, la découpe de ses feuilles, que par la grosseur et la forme de ses fruits (…) leur pubescence est elle-même variable : elles peuvent rester complètement velues en dessous tout l’été ou devenir tôt à peu près glabres (…) Les feuilles sont marescentes, c’est-à-dire qu’elles persistent, desséchées, sur l’arbre, jusqu’au printemps.
Chêne pubescent : le bois et ses usages
A. Mathieu, Conservateur des forêts, dans sa Flore forestière, 4e édition en 1897, dit : Le bois du chêne n’est au premier rang pour aucune des propriétés qui distinguent la matière ligneuse ; il n’est ni le plus lourd, ni le plus dur, ni le plus souple, ni même le plus nerveux des bois ; mais il réunit toutes ces qualités dans une telle mesure, il présente une telle durée employée à l’air ou dans l’eau, il peut acquérir de telles dimensions, qu’il est sans contredit le plus précieux de tous ceux que produisent nos forêts…
De Ménandre, auteur grec du IVe siècle avant JC, écrivait déjà, dans une de ses sentences monostiques : Quand le chêne est tombé, chacun se fait bûcheron.
Que dit, quant à elle, la Flore forestière française à propos du Chêne pubescent ? Que c’est un bois dense et dur, difficile à travailler, dont les utilisations sont limitées par la forme et la dimension des arbres : utilisé occasionnellement pour la charpente, le merrain, la construction navale et les traverses de chemin de fer ; surtout apprécié comme combustible, bon charbon de bois…
Le bois du chêne pubescent, plus dur, plus compact, plus noueux que celui des grands chênes du nord, ne sert plus de nos jours qu’au chauffage, usage pour lequel néanmoins il continue d’exceller.
Chêne pubescent : approche ethnobotanique
Les usages thérapeutiques
C’est le tanin du chêne qui est d’usage thérapeutique. L’écorce en contient 15 à 20%, les feuilles, comme les glands, un peu moins, de 5 à 8%, mais les galles près de 50%. L’écorce et les feuilles sont astringentes, toniques et antiseptiques. Mais ce tanin est irritant : son utilisation médicinale doit donc être réservée à un usage externe (en particulier l’écorce).
Grecs, romains et gaulois employaient les glands et l’écorce de chêne contre les diarrhées, la dysenterie, les hémorragies, les fièvres… Ils s’en servaient également comme anti-poison en l’appliquant sur les blessures des flèches empoisonnées, les morsures de serpent. Pascal Gérold [Livre Les arbres nourriciers ] évoque également son efficacité anti-saignement, du nez notamment, et son usage par les anciens contre les vers intestinaux. Toutes ces propriétés ont depuis été validées par la médecine moderne. François Couplan [ Le petit Larousse des plantes qui guérissent ] indique que de nos jours, on utilise l’écorce contre les leucorrhées, les fissures anales, les hémorroïdes et, en gargarisme, contre les angines.
Les usages agricoles
Les chênes produisent tous les 6 ou 7 ans des glandées particulièrement abondantes. Il y a des années de pleines glandées et des années moins fertiles dites de demi-glandées ou de quart-glandées. Les glands sont les fruits les plus abondants des forêts de basse altitude en Europe occidentale. C’est pourquoi, en Europe, les glands, doux ou amers, ont été utilisés pour nourrir les animaux d’élevage, et engraisser les porcs, action qui se nommait glandage. Au Moyen-âge, la valeur d’une forêt se mesurait d’avantage au nombre de cochons qu’elle pouvait nourrir qu’à la valeur de son bois. Michel Brunner [ livre Arbres géants de Suisse ] cite cette expression : « Sous les chênes grandissent les meilleurs jambons« .
Autres usages
Par les tanneurs
L’écorce de chêne est riche en tanin. Pulvérisée, elle donne le tan utilisé pour le tannage des peaux, afin de les rendre imputrescibles et d’en faire du cuir. Les galles étaient également utilisées.
Par les trufficulteurs
Avec le Chêne vert et le Chêne rouvre, le Chêne pubescent, aussi appelé chêne truffier, est une des principales espèces de chêne utilisée pour la trufficulture.